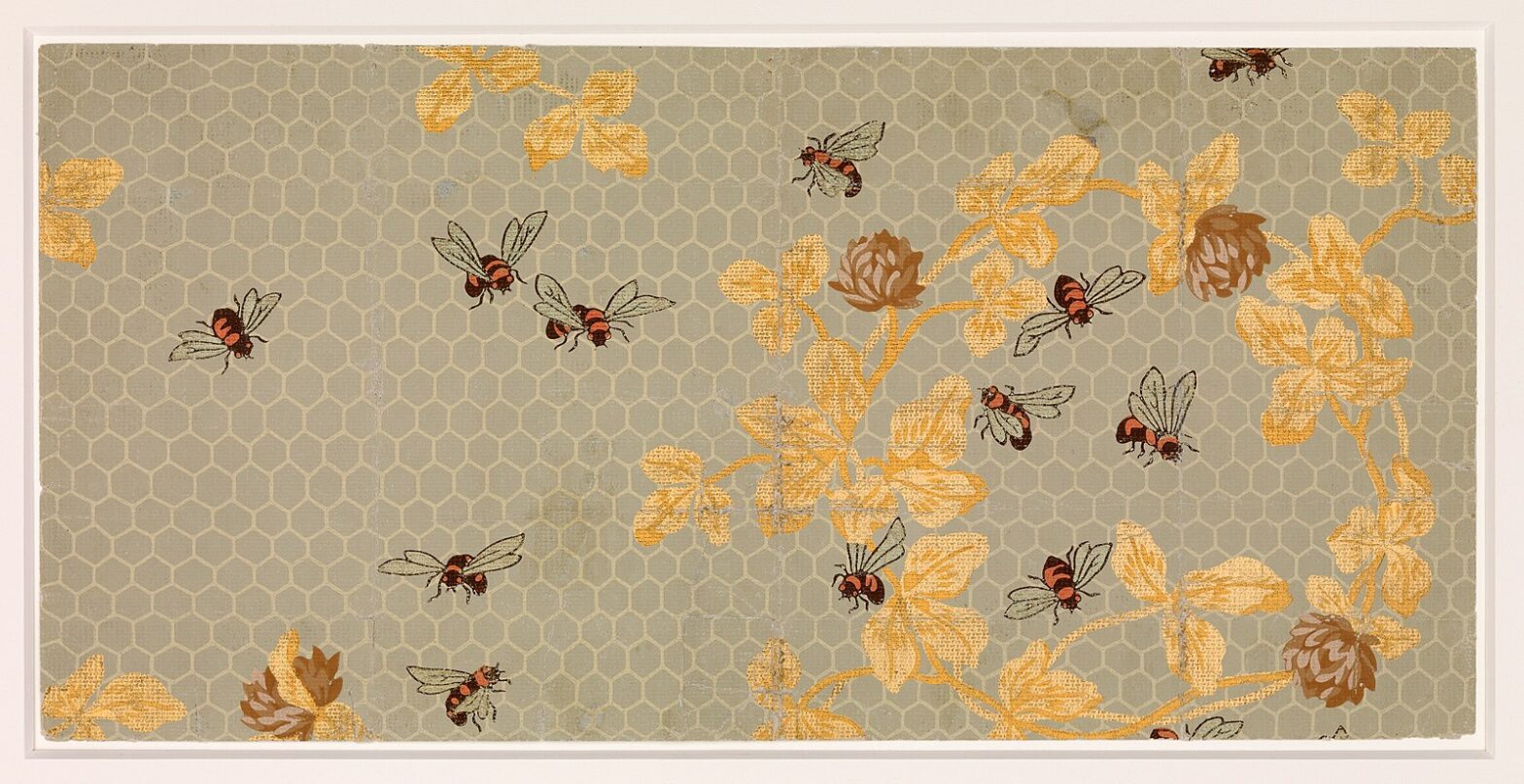
Ouvrir pour durer : penser les infrastructures numériques publiques à l’ère des communs
Les discussions récentes, que ce soit lors de la conférence NEC 2025 à Paris (voir la synthèse) ou du forum international “Connecting the European Tech Business Offer with Vietnam’s digital future” tenu à Hô Chi Minh City, convergent vers un constat commun : le débat sur la place et le rôle de chacun face au numérique se précise (et le terrain de jeu est international). Ci-après une synthèse des réflexions qui seront prolongées lors du webinaire Open Source Experts « Souveraineté sans rivalité, la voie de l’Open Source ? » du 14 novembre 2025.
Après plusieurs années d’attention concentrées sur la blockchain, les jumeaux numériques et l’intelligence artificielle, le sujet de l’infrastructure numérique revient au premier plan. À la fois matérielle et logicielle, la période géopolitique actuelle nous rappelle que cette infrastructure est devenue essentielle au développement de nos sociétés (à l’instar des routes et des ponts, ou encore des réseaux électriques ou sanitaires).
Plus que tout autre et en raison de leur objet, les Digital Public Infrastructures (DPI) doivent être pensées dans une logique d’ouverture et de collaboration, au travers notamment de ce que l’on dénomme aussi l’Open Digital Infrastructures (ODI) – des communs numériques sur lesquels reposent l’innovation, la confiance et la souveraineté des États.
S’il existes plusieurs études de référence sur le sujet — telles celle de Nadia Eghbal (Roads and Bridges: The Unseen Labor Behind Our Digital Infrastructure) ou celles d’OpenFuture (voir notamment Digital Commons as Providers of Public Digital Infrastructure) –, il reste encore du travail avant de faire émerger un consensus en la matière.
1- Rapprocher les Digital Public Infrastructures de l’Open Digital Infrastructure
Dans le domaine du numérique, le mot “infrastructure” évoque rarement le code ou la maintenance. Pourtant, tout le monde reconnait que les systèmes d’information modernes reposent sur des composants ouverts : systèmes d’exploitation, bibliothèques, frameworks web et bases de données libres. Parmi ceux-ci, un nombre important est partagé dans un modèle Open Source, entretenue par des communautés, des (petites) entreprises et des institutions publiques.
Alors qu’elles nous sont nécessaires, ces « dépendances » ne bénéficient que rarement d’un financement pérenne. Sans politique claire de maintenance et de contribution, la souveraineté numérique demeure illusoire. Les infrastructures logicielles doivent être reconnues comme des biens publics critiques, dont la continuité relève de la responsabilité collective — au premier chef celle du secteur public. L’étude FOSSEPS réalisé par le cabinet en 2022 apporte des éléments concrets en ce sens.
La notion de Digital Public Infrastructure (DPI), portée par l’UNDP, désigne les couches partagées – identité numérique, paiements, échange de données – qui soutiennent les services publics. Mais la conférence de Hô Chi Minh City a permis de développer une évolution importante dans la manière dont on pense ce type d’infrastructure (et qui rejoint les débats publics-privés du moment) : une infrastructure numérique, fusse-t-elle publique, ne peut être durable que si elle est ouverte. C’est tout le sens du passage de la DPI à l’ODI. L’ouverture garantit la transparence, la mutualisation et la résilience face aux dépendances technologiques. Voir à ce sujet des présentations telles « Why open digital infrastructure matters » de Charles H. Schulz (Vates).
Plusieurs exemples évoqués en témoignent : X-Road, en Estonie ; LF Energy, initié par RTE ; OpenSpaceMakers initié par le CNES ; ou encore la Suite Numérique, en France, soutenue par l’EDIC sur les communs numériques.
2. Une responsabilité partagée entre secteur public et privé
À l’exception du Sovereign Tech Fund allemand, l’un des angles morts des politiques numériques demeure la maintenance. Les mainteneurs – que ce soit des personnes indépendantes, salariées ou des agents publics – constituent la base silencieuse des infrastructures ouvertes. Les discussions internationales invitent à la discussion d’un contrat social du numérique : le secteur public finance la maintenance critique, les communautés innovent et les entreprises assurent la scalabilité.
Ce modèle hybride reflète la philosophie des communs : une gouvernance distribuée mais structurée. Les initiatives européennes, notamment l’EDIC, incarnent ce nouvel équilibre qui devra maintenant être éprouvé.
Au-delà, les récents échanges (que ce soit à Strasbourg lors de NEC 2025 ou à l’autre bout du monde) ont tous souligné le rôle central de l’État dans la structuration des infrastructures numériques. Que ce soit seul ou en réinventant les collaborations avec les autres États ou le secteur privé, le secteur public doit rester le garant de la continuité et de la maintenance de cette infrastructure. Pour ce faire, il doit financer les composants ouverts essentiels et créer un cadre de gouvernance pour les acteurs privés et communautaires engagés conjointement à ses côtés.
Cette approche rejoint la stratégie open source de la Commission européenne (que ce soit avec le Cyber Resilience Act, l’IA Act ou encore l’Interoperable Europe Act) : l’ouverture et la collaboration sont indissociable des enjeux de sécurité et de souveraineté. Le rôle des États est donc de donner le cadre et les impulsions afin d’orchestrer globalement l’écosystème européen du numérique vers un futur plus soutenable, à la mesure de nos ambitions.
Les politiques européennes – AI Act, Cyber Resilience Act, Interoperable Europe Act – renforcent la transparence et la réutilisation. Les programmes comme les NGI Cascading Grants ou le Sovereign Tech Fund (aujourd’hui Sovereign Tech Agengy) reconnaissent les mainteneurs comme acteurs d’infrastructure. Cette dynamique inspire des coopérations internationales, les échanges menés mettant en évidence la complémentarité entre l’expérience européenne et les ambitions internationales (que ce soit l’US, la Chine ou des acteurs tels que le Vietnam qui souhaitent assurer la maitrise de cette infrastructure). Ce seront des sujets aussi discutés dans le cadre de la conférence Commons AI du 10 décembre 2025.
Vers une approche systémique du numérique public
L’ouverture n’est pas un désengagement, mais un partage des responsabilités. Elle exige des cadres de coopération et des dispositifs de financement adaptés à la réalité d’un numérique distribué et hautement humain. Les États ont aujourd’hui l’opportunité de bâtir des écosystèmes numériques vivants, où les communs technologiques deviennent un pilier de la souveraineté et de la durabilité.
Repenser les Digital Public Infrastructures comme des biens communs ouverts revient à redonner à la puissance publique un rôle d’organisateur et de garant du long terme, tout en valorisant les contributions des écosystèmes communautaires et privés. Cette articulation – entre soutien public, participation collective et innovation ouverte – constitue la clé d’un numérique souverain et durable.
Au-delà des textes législatifs, les programmes européens 2030 – en particulier l’initiative Open Internet Stack – marquent une étape clé. Ce programme vise à créer un cadre open source européen, développé selon le modèle des communs numériques et soutenu par les États. Son ambition : bâtir un écosystème d’infrastructures ouvertes, interopérables et gouvernées par des communautés de contributeurs. Ce faisant, l’Europe assume de désormais s’assurer de l’émergence ou de la consolidation de briques souveraines qui s’appuient sur une gouvernance publique-privée.
Crédit Image : Gift of Sunworthy Wallcoverings, a Borden Company, 1987 (crédits)
Auteur/Autrice

Collectif inno³
Ressources associées

Projet
FOSSEPS
![Table ronde animée par Benjamin Jean lors de Numérique en Commun[s] 2025](https://inno3.fr/wp-content/uploads/2025/10/20251029_141956-1-343x350.jpg)
Article
La rentabilité des communs numériques, un point de dialogue entre acteurs publics et privés pour un numérique ouvert et souverain
Organisation impliquée
Commission européenne
Ministère de l’Enseignement Sup. et de la Recherche
Agence nationale de la cohésion des territoires
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM)
